Sept ans de réflexion (5/5)
En bon pénitent, j’ai attendu sans rien dire que la mayonnaise retombe. Une semaine. Un mois. Un autre mois.Arrivé au trimestre, il a bien fallu se rendre à l’évidence : les choses risquaient de mettre un peu plus longtemps que prévu à se calmer.
Deux solutions s’offrent alors à moi : d'abord, faire mon attention whore et tous les flinguer. Un truc grandiose, comme on les voit à la télé, où je finirais par me jeter à la Seine, sur une musique dramatique. Ou plan B, plus simple et efficace, je quitte l’entreprise.
J’avais regardé vite fait des modèles de lettres, pour être sûr d’employer les bons termes, et pas juste leur balancer un truc du genre « je me casse, bande de putes ». Je l’avais en tête, mais j’attendais, que les choses se calment, ou que tu me reviennes à nouveau. Allez, si demain ça va pas mieux, j’arrête, c’est promis. Mais fais-moi mal encore un peu s’il te plaît…
Et puis un samedi de juillet, en plein boom, je me suis rendu compte que ça ne s’arrangerait jamais. Ça fait plus de trois mois, et rien n’a bougé : ceux qui me détestent n'ont aucune raison de s'arrêter, il n’y aura pas de plus gros scandale pour faire contre-feu. Alors je suis allé m’enfermer dans un bureau, et en trois minutes, j’avais tapé et imprimé ma lettre de démission.
Le cœur battant comme une pucelle, je suis allé la montrer, tout fier, à un de mes potos, pour bien inscrire ce moment dans la réalité. Regarde, j'en peux plus je me barre ! Il m’a conseillé d’aller en discuter avant avec la remplaçante de Girafa, en vacances à ce moment-là. Je l’ai croisée dans le couloir, ladite Suppléante. Je lui ai souri. Et je suis allé donner ma lettre au secrétariat, aussi délicatement qu’on dépose sa crotte au fond des toilettes.
Une demi-heure après, tout le service avait été mis au courant par une nouvelle source anonyme, qui ne travaillait même pas ce jour-là.
Me, me, me against them, me against enemies, me against friends, comme le dirait madame Minaj. Elle dit de belles choses, madame Minaj.
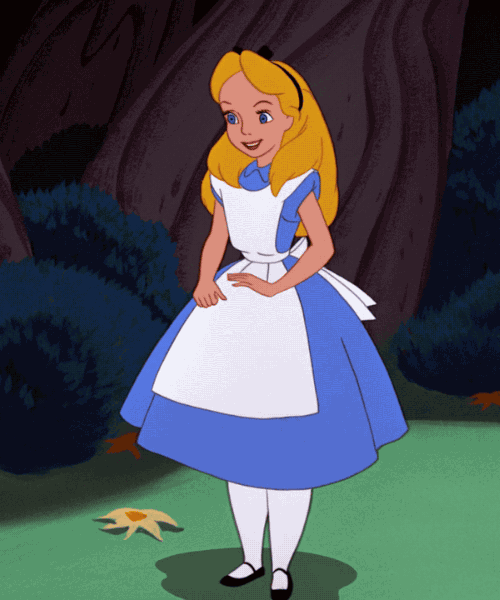
Une fois retombée l'euphorie de la capitulation, ce sentiment de liberté post-rupture, allez, fais pas l'innocent tu le connais, je me suis rendu compte que les choses n’étaient pas aussi roses que je l’avais imaginé. Bizarrement, aucun membre du camp adverse n’est venu me voir en me disant que c’était dommage, que j’allais leur manquer, et qu’ils étaient désolés si les derniers mois avaient été un peu difficiles, allez, reste, je suis arrivé juste avant que tu ne prennes ton avion, et je te le demande sous la pluie.
On a plutôt sorti le champagne, en parcourant les noms sur les plannings, pour savoir qui allait prendre ma place : « une langue de pute s’en va, laquelle va la remplacer ? ».
Mon préavis était de trois mois. Père courage, je m’étais dit « pa ni pwoblem, je les ferai les doigts dans le nez » (mais sans dignité, les deux me semblant difficilement compatibles).
L’ambiance s’est dégradée encore plus -si si, c’est possible !- autour de moi, quand la nouvelle de ma chute a été officialisée, c'est à dire dès le lundi matin. J’ai demandé à la remplaçante de Girafa, à mon chef de service, aux ressources humaines, à Vishnou, s’il était possible de ne pas faire mon préavis.
Comme je suis quelqu’un d’irremplaçable, on me l’a refusé.
J’ai coulé aussi vite que le Titanic : deux jours après ce dernier entretien, j’étais chez le médecin, qui m’arrêtait jusqu’à la date effective de ma démission.
Au mois de septembre, ça aurait fait 7 ans que je travaillais là-bas, à me construire, petit à petit, un univers, un métier rigolo, une vie sociale, des collègues qui m’appréciaient (introduire ici un montage de mes plus grands moments, au ralenti, des grands éclats de rire, et aussi, aussi, on me verrait travailler d'arrache-pied, oui, voilà, tu as compris l’idée). Je suis parti comme un voleur, par la petite porte, avec le grand PFFFFT d’un pétard mouillé.
Les derniers rapports que j’aie eus avec ma hiérarchie, ça a été cet échange de mails avec La Suppléante, où je l’informais de mon arrêt de travail. Ma work-femme m’avait dit qu’elle était assez fâchée que je chamboule les plannings comme ça, alors je me suis justifié, une dernière fois : je ne peux plus venir, la situation était devenue trop insupportable, je suis sincèrement désolé.
Je n’ai pas gardé son dernier courrier, je ne suis pas si fétichiste, mais en gros, elle m’expliquait qu’elle ignorait qu’il y « ait eu de telles tensions autour de moi » -le chef de file des anti n’était après tout qu’une de ses proches amies-, que je devais m'estimer « chanceux d’avoir gardé des amis dans le service, mes écrits étant très blessants ». Oui voilà, chanceux, c'est exactement comme ça que je le vis, merci d'avoir mis des mots sur mon ressenti.
Je me souviens surtout de sa dernière phrase, gardons le meilleur pour la fin : « Que cette mésaventure te serve de leçon, bonne continuation ».
Je. Euh. Whatever.
Trois mois d'enfer, à me sentir sale, violé, mis à nu, humilié, honteux.
Et j'étais enfin libre.
